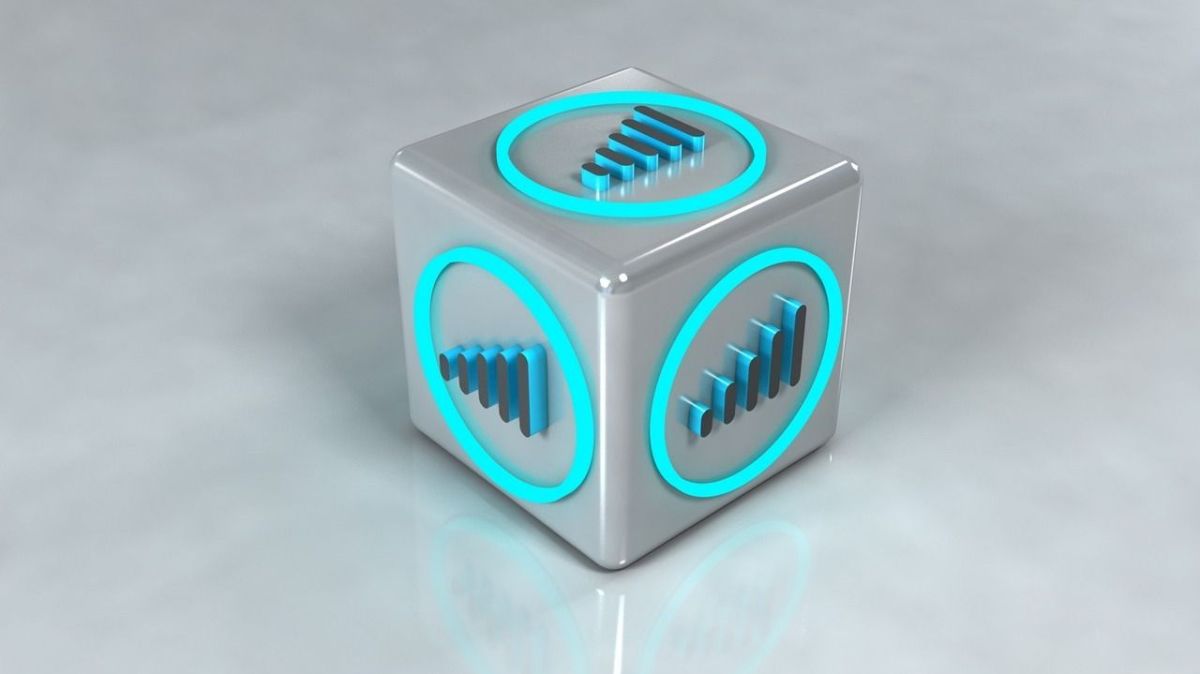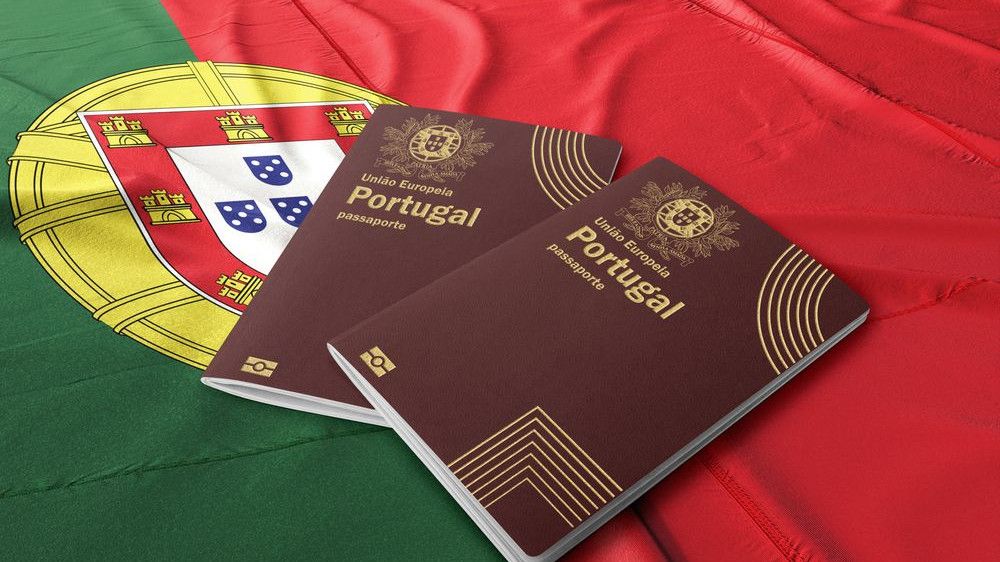Cependant, c'est précisément dans les moments de grande difficulté que se présentent les opportunités de repenser et de transformer le paradigme urbain national. Une réforme stratégique, intégrée et ambitieuse peut être la voie vers des villes plus inclusives, durables et compétitives.
Le premier pas vers une réforme urbaine efficace est d'abandonner les réponses réactives et fragmentées, en pariant sur une vision à long terme qui implique tous les agents du secteur : décideurs politiques, entités administratives, promoteurs immobiliers, associations de consommateurs, urbanistes et juristes. Ce n'est que par le dialogue et le partage des responsabilités qu'il sera possible de construire un cadre réglementaire transparent, prévisible et capable d'attirer les investissements, tant nationaux qu'internationaux, sans sacrifier l'intérêt public.
Il est essentiel de simplifier les procédures d'autorisation. La multiplicité des démarches, des avis et des exigences documentaires a été l'un des principaux obstacles à l'augmentation de l'offre de logements, à la pression sur les prix et à l'éloignement des investisseurs. Une administration publique plus efficace, numérisée et axée sur les résultats peut débloquer des projets, accélérer les réponses et garantir une plus grande justice et équité dans l'accès au logement.
L'expérience internationale offre des exemples inspirants de réformes urbaines réussies. À New York, le projet High Line a transformé une ancienne voie ferrée surélevée en un parc urbain, revitalisant toute la zone environnante, encourageant la réhabilitation des bâtiments et créant des espaces publics de qualité. Paris a misé sur les forêts urbaines et la requalification des quartiers périphériques, conciliant durabilité environnementale et inclusion sociale. Barcelone, pour sa part, a mis en œuvre le concept de "superblocs", limitant la circulation automobile dans certaines zones pour rendre l'espace public aux citoyens, favorisant ainsi la mobilité douce, le commerce local et la coexistence des communautés.
Ces exemples montrent qu'il est possible de revitaliser des zones dégradées, de promouvoir la régénération urbaine et de créer des villes plus vertes et plus humaines, s'il existe une volonté politique, une planification stratégique et une implication de la société civile. Au Portugal, des initiatives telles que le plan vert de Lisbonne et les programmes de réhabilitation urbaine commencent déjà à porter leurs fruits, mais il est nécessaire d'aller plus loin, en veillant à ce que toutes les municipalités disposent de plans d'occupation des sols actualisés et conformes aux besoins actuels.
Un autre axe fondamental de la réforme urbaine est l'articulation entre les politiques de logement, de location et de réhabilitation. L'accès à un logement adéquat doit être une priorité, en promouvant des loyers abordables, la reconversion des biens vacants et la réhabilitation comme règle. L'implication de l'État, des municipalités, des coopératives et du secteur privé est essentielle pour mobiliser les ressources, accélérer les projets et s'assurer que les solutions atteignent ceux qui en ont le plus besoin.
L'innovation et la numérisation doivent être des alliés de la réforme. Les plateformes électroniques pour la soumission et le suivi des projets, l'interopérabilité entre les systèmes municipaux et les entités externes, et l'utilisation de technologies telles que la modélisation des données du bâtiment (BIM) peuvent accroître la productivité, réduire les déchets et promouvoir l'efficacité énergétique.
Enfin, il est essentiel de garantir la sécurité juridique et la confiance des investisseurs. La prévisibilité réglementaire, la transparence des processus et l'articulation entre les différents régimes sont des facteurs décisifs pour stimuler le marché immobilier, sans perdre de vue l'intérêt public et la cohésion sociale.
En résumé, le Portugal a devant lui l'opportunité d'inaugurer un nouveau paradigme urbain, en s'inspirant des meilleurs exemples internationaux et en les adaptant à sa réalité. L'avenir des villes portugaises dépend du courage de réformer, de la capacité d'unir des intérêts divers et de construire des solutions qui durent dans le temps, en promouvant le bien-être des populations et le développement durable des territoires.